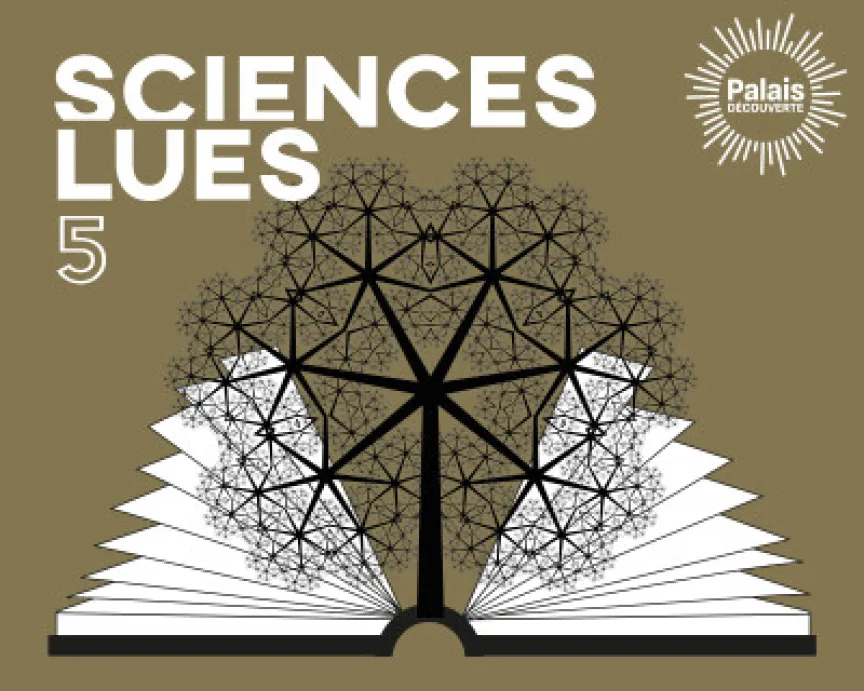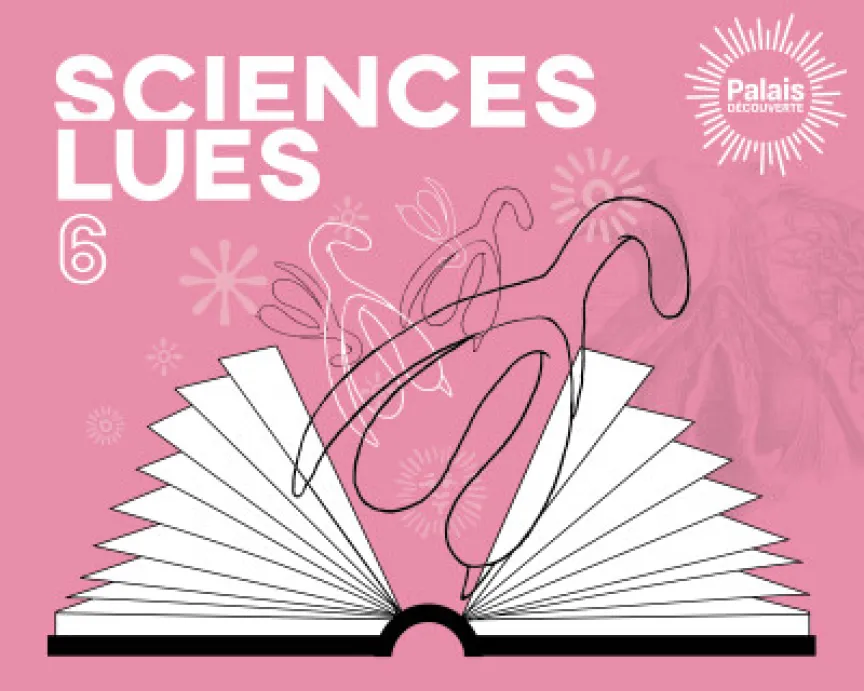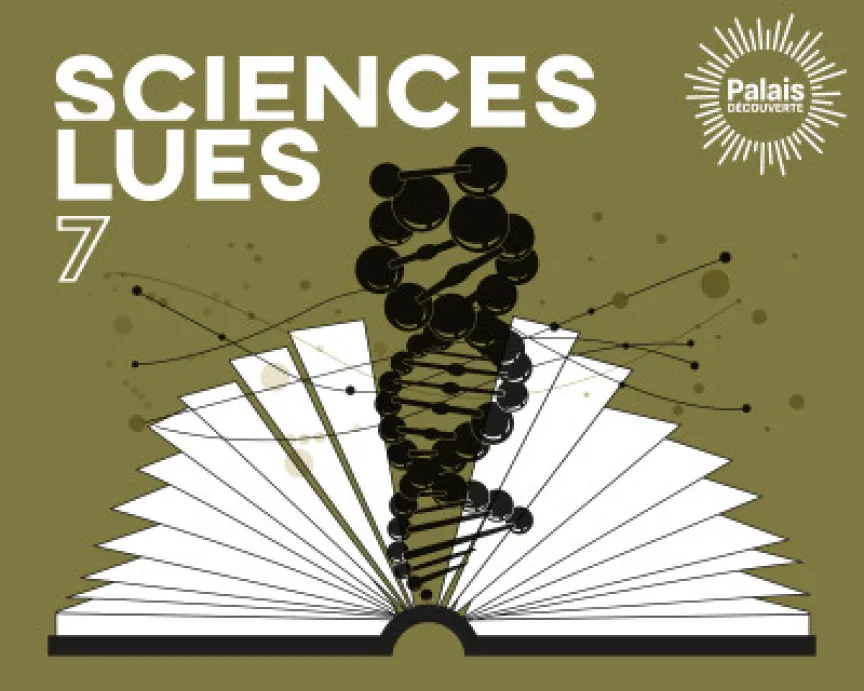Neal Stephenson - Quicksilver (S2E4)
Liste des intervenants
- Alexandre Héraud (voix off)
- Léa Minod (journaliste)
- Emmanuel Sidot (médiateur)
- Greg Germain, Audrey Stupovski et Alexandre Héraud (lecture)
Léa Minod : Morceau instrumental des Pink Floyd, marque de vêtements de montagne, super-héros de chez Marvel, ancien nom donné au mercure, en anglais quicksilver, c'est aussi un livre, et pas n'importe lequel : le premier tome d'une trilogie de 9 000 pages au total, imaginé par le très, très, très prolifique Neal Stephenson en 2003, et d'ailleurs qu'aucun éditeur français n'a encore eu le courage de traduire. Cet auteur américain, physicien et géographe de formation, est sans doute aujourd'hui reconnu comme l'un des écrivains les plus importants de science-fiction. C'est lui que vous avez choisi de nous faire découvrir aujourd'hui, Emmanuel Sidot, médiateur en physique du Palais de la découverte, bonjour !
Emmanuel Sidot : Bonjour.
Léa Minod : Quand avez-vous lu pour la première fois ce livre Quicksilver ?
Emmanuel Sidot : Quicksilver, dès qu'il est sorti en 2003, cela a été un délice, parce que, comme chaque œuvre de l'auteur que je lisais avec assiduité déjà depuis peut-être une petite dizaine d'années, j'ai trouvé cela très, très long. J'ai lu le premier tome, puis j'ai fait une pause, j'ai lu les deux autres tomes dans la décennie qui a suivi.
Léa Minod : Très très long, c'est-à-dire que vous vous êtes ennuyé un peu ?
Emmanuel Sidot : Non, c'est juste que pour se goinfrer 3 000 pages, aussi excellentes, truculentes et succulentes soient-elles, il faut du temps et à un moment, la vie quotidienne fait qu’on va passer à autre chose.
Léa Minod : Et vous l'avez lu en anglais, donc ?
Emmanuel Sidot : Oui.
Léa Minod : Comment avez-vous découvert Neal Stephenson ?
Emmanuel Sidot : Comme beaucoup de garçons des années 80-90, j'ai grandi en lisant de la science-fiction, genre cyber punk, et ses premières œuvres ouvraient là-dedans.
Léa Minod : C'est un genre cyber punk ?
Emmanuel Sidot : C'est un genre de science-fiction. C'était la pointe de la science-fiction dans les années 80, le début de l'informatique, le reaganisme, le thatchérisme politique poussé à son extrême, une dystopie informatique et ultra-libérale qui est moins à la mode aujourd'hui, puisque, apparemment, les prédictions se sont en grande partie réalisées, dira-t-on.
Léa Minod : Et pourquoi avez-vous choisi ce texte de Quicksilver en rapport avec la physique ?
Emmanuel Sidot : Parce que justement, ce texte-là de Stephenson parle des grands noms de la physique de ses débuts : Samuel Hook, Leibniz, Newton en particulier. Ce roman-là, qui est une grande fresque historique, rocambolesque, un vrai feuilleton façon Dumas, parle de physique, d'Isaac Newton, du personnage et de ses premiers travaux. Il le met en scène et c'est de la science-fiction qui rejoint ce que je fais tous les jours : parler de médiation scientifique en physique.
Léa Minod : Donc c'est un livre de médiation ?
Emmanuel Sidot : J'aurais tendance à dire que tous les livres de Stephenson sont des livres de médiation. C'est un monsieur extrêmement cultivé, un gros geek comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à tout de près. Lorsqu'il fait des recherches documentaires pour faire un livre, il les fait vraiment, il va chercher des sujets qui flattent son esprit curieux, compliqués, scientifiques, complexes, techniques, économiques et il va expliquer toutes ces choses-là pour donner une toile de fond à ses romans. En général, il explique extrêmement bien, c'est vraiment un médiateur dans l'âme. C'est quelqu'un qui m'inspire dans mon métier.
Léa Minod : C'est vrai ?
Emmanuel Sidot: Oui !
Léa Minod : Vous vous êtes inspiré de lui ?
Emmanuel Sidot : J'essaye. Je le regarde un petit peu de bas. Je le trouve extrêmement brillant et je ne suis pas encore assez satisfait de mes compétences face aux siennes. Je le trouve extrêmement brillant et écrasant.
Léa Minod : Vous êtes fan !
Emmanuel Sidot : Je suis un grand fan !
Léa Minod : Qui sont les personnages dans l'extrait que l'on va entendre ? Il y a par exemple Daniel Waterhouse, qui est-ce lui ?
Emmanuel Sidot : C'est un personnage fictif. C'est un autre étudiant de Cambridge, du Trinity College, où travaille à ce moment-là Isaac Newton. Il est devenu son assistant pour l'aider dans ses recherches, voire l'assister dans sa vie de tous les jours. Isaac Newton y est présenté comme quelqu'un d'assez détaché de la vie quotidienne, un petit peu perdu dans la vie quotidienne, ce qui doit être relativement vrai historiquement. Il est en tout cas traité comme un profil de geek complet. Il est traité de manière assez brutale, de manière très caricaturale. Il est un peu perdu, il n'est pas sûr qu'il sache toujours s'habiller tout seul. Et Daniel Waterhouse est son assistant, aussi bien son partenaire de réflexion intellectuelle, parce que Daniel est assez éduqué lui-même, il est quand même élève du brillant Trinity College, que son assistant de vie tous les jours.
Léa Minod : Il y a aussi quelqu'un dont il est fait référence, c'est John Flamsteed. Qui est-ce John Flamsteed ?
Emmanuel Sidot : C'est un astronome qui avait, un peu avant Newton, produit les calculs de position des astres, des planètes notamment, les plus précis de l'époque. C'est l'astronome qui a donné les données de référence pour que Newton établisse la loi de la gravitation universelle.
Léa Minod : ll est question de John Flamsteed et de Isaac Newton : est-ce qu'ils étaient contemporains tous les deux ?
Emmanuel Sidot : Ils ont dû se côtoyer. Mais Flamsteed, c'était lui qui avait fait les données les plus précises sur les mouvements des planètes, sur lesquelles Newton s'est basé pour faire ses propres travaux.
Léa Minod : Pourtant, on a vraiment une sensation d'animosité entre les deux quand il est fait référence de Flamsteed.
Emmanuel Sidot : Ah non ! Ce n’est pas une animosité, je ne crois pas. Je crois que c'est un vrai respect pour la qualité de son travail, non pas de théoricien, mais d'astronome de terrain qui a donné des mesures précises. Justement, c'est une référence dont il faut se garder. Newton craint que ses réflexions, sa théorie, rentre en contradiction un jour avec ce que John Flamsteed pourrait observer. Donc ce n’est pas de l'animosité, c'est une crainte respectueuse pour la qualité de l'observation du réel qu'apporte un grand astronome comme Flamsteed.
Léa Minod : Alors, où on en est dans l'histoire au moment où vous avez choisi cet extrait ? On rappelle : il y a Daniel Waterhouse qui vient voir Isaac Newton dans son laboratoire au Trinity College, c'est cela ? Et que va-t-il se passer ou que s’est-il passé ?
Emmanuel Sidot : On est vers la fin du premier acte de cette grande fresque, le moment où la situation va changer. Elle n'a pas encore changé, mais elle va changer. Ce qui se passe, c'est que Daniel entretient avec Newton une relation confuse, on va dire, c'est une véritable romance platonique, mais...
Léa Minod : Ils sont amoureux ?
Emmanuel Sidot : Daniel Waterhouse est complètement amoureux d'Isaac Newton. C'est un amour intellectuel. Il n'y a pas de sexualité en jeu du côté de Daniel, pas du tout. Daniel est très attiré par un autre personnage de l'histoire, la véritable « Angélique Marquise des anges de l'histoire », une femme incroyable qui s'appelle Elisa. Mais sinon oui, il a une amitié, un amour profond, intellectuel, une admiration sans bornes pour Isaac Newton, et il se rend compte qu'il ne peut pas exister à côté de lui. Il va falloir qu'il change de vie, qu'il s'éloigne de lui, bref, qu'il rompe avec lui…
Léa Minod : Il quitte le père ?
Emmanuel Sidot: Il quitte le père, il quitte son amant écrasant, intellectuel, et il a du mal à lui dire, parce qu'il est dans la confusion des sentiments. Cette scène est l'une des scènes qui amène à son départ. Il va aller plus tard en Amérique, aller participer à la fondation d'une université qu'on imagine tout à fait être l'université d'Harvard.
Léa Minod : Alors on remonte le temps et on se faufile dans le laboratoire de Newton.
Lecture : « Daniel Waterhouse est un personnage fictif, étudiant à Trinity College, témoin pas si naïf des œuvres des grands noms de l'histoire des sciences de cette fin du XVIIe siècle européen. On le découvre ici rendant visite à Isaac Newton dans son laboratoire.
Daniel Whaterhouse : Mais il semblerait que vous ayez tout expliqué.
Isaac Newton : Je n'ai pas expliqué la loi des carrés inverses.
Daniel Whaterhouse : Vous avez une preuve juste là, disant que si la gravité suit une loi des carrés inverses, les satellites se meuvent sur des sections coniques.
Isaac Newton : Et Flamsteed dit qu'elles le font.
Isaac répondit en tirant le feuillet de note de la poche de Daniel. Ignorant la lettre d'introduction il tira le ruban du paquet et se mit à parcourir les pages.
Isaac Newton : Donc la gravité suit effectivement une loi des carrés inverses. Si ce soir Flamsteed repère une comète se mouvant en spirale, cela prouvera que tout mon travail est faux.
Daniel Whaterhouse : Ce que vous dites, c’est : pourquoi avons-nous besoin de Flamsteed ?
Isaac Newton : Je dis que le fait que nous ayons besoin de lui prouve que Dieu fait des choix.
Daniel Whaterhouse : Seulement parce qu'il reste encore certaines choses que vous n'avez pas expliquées par une preuve géométrique.
Isaac Newton : Comme je vous l'ai dit, je cherche Dieu là où la géométrie fait défaut. »
Léa Minod : Emmanuel Sidot, on a beaucoup de chance d'entendre ce texte en français. C'est vous qui l'avez traduit ?
Emmanuel Sidot : En l'occurrence oui, j'ai été obligé, puisqu'il n'est pas traduit. Les éditeurs ont reculé devant la masse de travail que cela imposait. 3 000 et quelques pages en anglais, ça veut dire au moins 4 500 en français, c'est un challenge éditorial.
Léa Minod : Qu'est-ce qui est dit précisément dans cet extrait ? On parle des lois, de la loi des carrés inverses et aussi du mouvement des satellites. De quoi s’agit-il ?
Emmanuel Sidot : Il s'agit de ce pourquoi Newton est célèbre en physique et de sa contribution majeure, qui a inspiré tout le reste de la physique. Son travail consistait à reprendre les travaux de Galilée et des autres mécaniciens ainsi que les données des astronomes pour essayer de comprendre, trouver les lois générales qui expliquaient le mouvement dans le Système solaire, les mouvements astronomiques. À partir des calculs astronomiques et de ce qui a été fait avant, il a réussi en définissant les forces, en définissant l'accélération, en reprenant le concept de l'inertie, à fabriquer un système qui démontrait par des raisonnements mathématiques – c'est ce qu'on entend par « géométrie » dans le texte à l'époque – que la force qui interagissait entre le Soleil et les planètes ou entre une planète et ses satellites, était une force qui diminuait en raison non pas de la distance, mais de la distance fois la distance, c'est-à-dire la distance au carré.
Léa Minod : C'est ça, la loi des carrés inverses ?
Emmanuel Sidot : C'est cela, c'est-à-dire que dans une équation mathématique, quelque part, il y aura un facteur qui sera en un sur la distance au carré, la distance au carré au dénominateur.
Léa Minod : À la fin du texte, il est fait référence à Dieu. Qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire Dieu ?
Emmanuel Sidot : On est à une époque, en cette fin du XVIIe siècle, où le monde reste croyant. En tout cas, tous les scientifiques le sont au moins ouvertement, parce qu'il serait totalement impossible de s'opposer à l'Église et espérer être publié. Newton, en l'occurrence, était probablement lui-même croyant, un croyant étrange, issu du protestantisme, mais pas vraiment protestant. C’était assez compliqué chez lui. Mais en tout cas, l'idée de Dieu comme raison première des choses reste dans l'esprit des scientifiques qui cherchent à comprendre, en philosophes de la nature, quelles sont les lois de la nature. Ces premiers scientifiques sont tous croyants. Newton est comme ça, enfin je pense que c'est une réalité historique. Il cherchait à trouver Dieu par la science, il cherchait à trouver où et comment il faisait des choix pour avoir déterminé que l'Univers était tel qu'il était. Il cherchait à aller plus loin que la seule raison représentée par la géométrie et par les mathématiques, et au-delà de ce que la seule raison humaine pouvait comprendre. Il cherchait où était la preuve du doigt de Dieu, dans quel sens Dieu avait poussé les choses. C'était sa quête. Il y avait un sentiment religieux qui animait beaucoup de ces scientifiques. Maintenant beaucoup de la science moderne qui, vous le savez sans doute, s’est laïcisée dirons-nous, a choisi de séparer le religieux de la recherche scientifique, a rendu la recherche scientifique matérialiste, à ne chercher des preuves que dans la matière. On pourrait moderniser Dieu pour une pensée de maintenant en le remplaçant par « la vérité scientifique ».
Léa Minod : Cela, c'est vous qui le dites !
Emmanuel Sidot : Oui, cela, c'est moi qui le dis, c'est ma façon de le comprendre.
Léa Minod : Et avez-vous fait l'expérience de remplacer dans ce texte Dieu par « la vérité scientifique » ?
Emmanuel Sidot : Oui, je trouve que ça représente assez bien les bases de ce que sont la physique moderne que de dire « je cherche la vérité là où la géométrie et les mathématiques font défaut ». Une fois qu'on a réussi, par les mathématiques, à démontrer quelque chose, on se demande toujours : mais comment aller plus loin ? Qu'est-ce qui se passe en dessous ? Pourquoi je m'explique ces choses-là en ces termes : pourquoi c'est comme ça ? On cherche à trouver une explication, éventuellement religieuse si on veut, ou en général matérialiste, pour expliquer pourquoi les forces sont comme ça. Par exemple, les forces de gravité aujourd'hui, toute la physique, jusqu'au XXIe siècle, a cherché à s'expliquer d'où provenait cette force de gravité. Aujourd'hui, on en est à l'idée que la gravité, sans qu'on sache encore exactement pourquoi, affecte l'espace-temps, le courbe, et cette courbe donne l'illusion d'une force. Une force non pas d'interaction entre les objets, comme pourrait être la force électrique, mais une force de l'ordre des forces d'inertie, le même genre de force que celle qu'est l'élan, par exemple. Vous courez, vous gagnez de l'élan et si vous ne vous freinez pas, vous continuez en ligne droite à la même vitesse. L'élan est une chose qui est une raison du mouvement, une force, et la gravité serait quelque chose comme cela. On a cherché à chaque fois à aller trouver des raisons sous-jacentes. On a remplacé Dieu comme raison première. On l'a oublié. On ne cherche plus la raison première, on cherche des raisons sous-jacentes, et c'est comme cela que la physique avance.
Léa Minod : Mais ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a une vraie interdisciplinarité entre les mathématiques, le langage mathématique et la physique, que l'un sans l'autre ne peut pas exister.
Emmanuel Sidot : Oui. À l'époque de Newton, ça faisait très longtemps qu'on avait prouvé qu'en astronomie, notamment, puisque son sujet touche l'astronomie, les mathématiques étaient indispensables. En philosophie, il y a même une très vieille école athénienne qui dit qu'on ne pouvait pas rentrer à l'académie si on n'était pas géomètre. Les mathématiques sont l'apprentissage du raisonnement logique et de la rigueur logique pour Platon, les mathématiques jouent toujours un rôle essentiel en science. Dans toutes les sciences, y compris en économie et en sociologie, les mathématiques ont une importance. C'est un outil extrêmement important de la pensée logique. Donc bien sûr qu'il y a des mathématiques en physique et, suite à l'exemple excellent de Newton, la physique a utilisé les mathématiques à outrance puisque cela marchait très bien.
Léa Minod : Comment pourrait-on définir ce livre ? C'est un livre de physique ? Un roman historique ? Qu'est-ce que c'est vraiment pour vous qui l’avez lu en entier ?
Emmanuel Sidot : Sans divulgâcher, c’est avant tout un roman-feuilleton rocambolesque. Prenez Angélique, marquise des anges.
Léa Minod : Le film ?
Emmanuel Sidot : Ou les livres d’Anne Golon, c'est encore mieux, Le bossu de Paul Féval ou Scaramouche, Mon Oncle Benjamin, si vous voulez, bref, roman picaresque de capes et d'épées, d'aventures, de pirates, les Amériques, le protestantisme, Louis XIV, les grandes guerres qui lui sont associées, le tout avec beaucoup d'aventures, de personnages incroyables et de situations rocambolesques. C'est avant tout ça le style de Quicksilver.
Léa Minod : Un roman d'aventures.
Emmanuel Sidot : C'est un roman d'aventures feuilletonnesque. C'est pour cela qu'il fait 3 000 pages.
Léa Minod : Et est-ce qu'on peut le lire si on n'y comprend rien à la physique ?
Emmanuel Sidot : Oui, puisque l'auteur se chargera notamment à longueur de pages, de vous expliquer au fur et à mesure quelle est la pensée d'Isaac Newton. Vous ne comprendrez pas la physique actuelle, vous comprendrez en quels termes Isaac Newton pensait, quels étaient les débats qu'il avait avec les autres, ce qu'il y avait à redire de sa personnalité. C'est une œuvre de médiation qui vise à bien comprendre ce personnage-là, entre autres.
Léa Minod [CONCLUSION] : Ainsi, ce court extrait de Quicksilver parvient à soulever les frontières entre physique et mathématique, rappelant les réflexions du physicien Richard Feynman, pour qui la physique est mathématisée, non pas parce que nous en savons beaucoup sur le monde physique, mais au contraire parce que nous en savons fort peu. Et comme un pied de nez à cette révolution scientifique en mouvement que décrit Neal Stephenson dans son livre, celui que l'on compare souvent à un « Umberto Eco high-tech », voire un « Umberto Eco sans le charme », ça, c'est un critique qui le dit, celui-là même se tient loin d'internet, et vous savez quoi ? Il rédige tous ces textes à la plume comme Isaac Newton. Pour d'autres plongées dans « Sciences lues », c'est le titre de cette série, rendez-vous sur le site du Palais de la découverte et sur les plateformes de podcast. Merci à Emmanuel Sidot, médiateur en physique du Palais de la découverte.
Morceau instrumental des Pink Floyd, marque de vêtements de montagne, super-héros de chez Marvel, nom ancien donné au mercure en anglais. Quicksilver, c’est aussi un livre et pas n’importe lequel ! Le premier tome d’une trilogie de 9000 pages, imaginée par le très très très prolifique Neal Stephenson en 2003. Cet auteur américain, physicien et géographe de formation, est sans doute reconnu aujourd’hui comme l’un des écrivains les plus important de science-fiction. Et c’est lui qu’Emmanuel Sidot, médiateur en physique au Palais de la découverte, nous propose de découvrir.