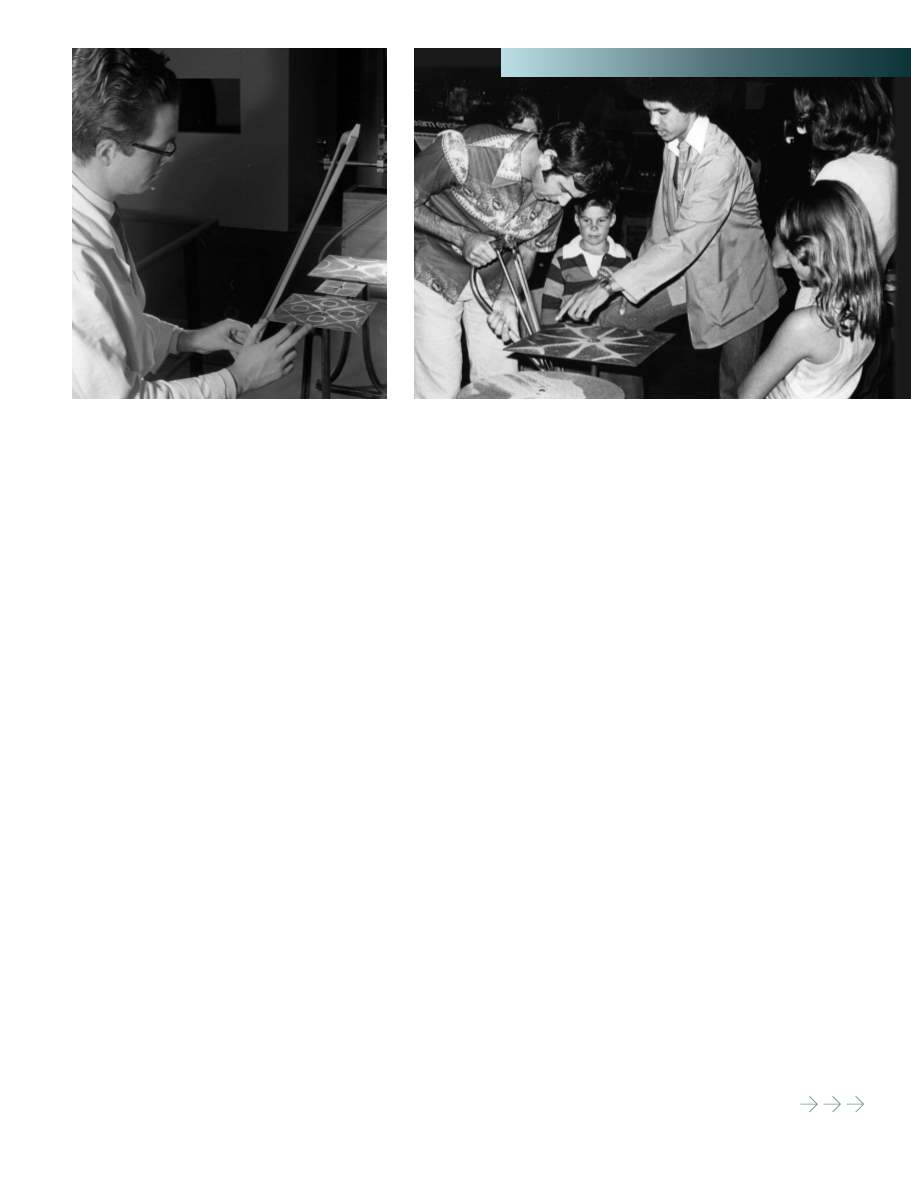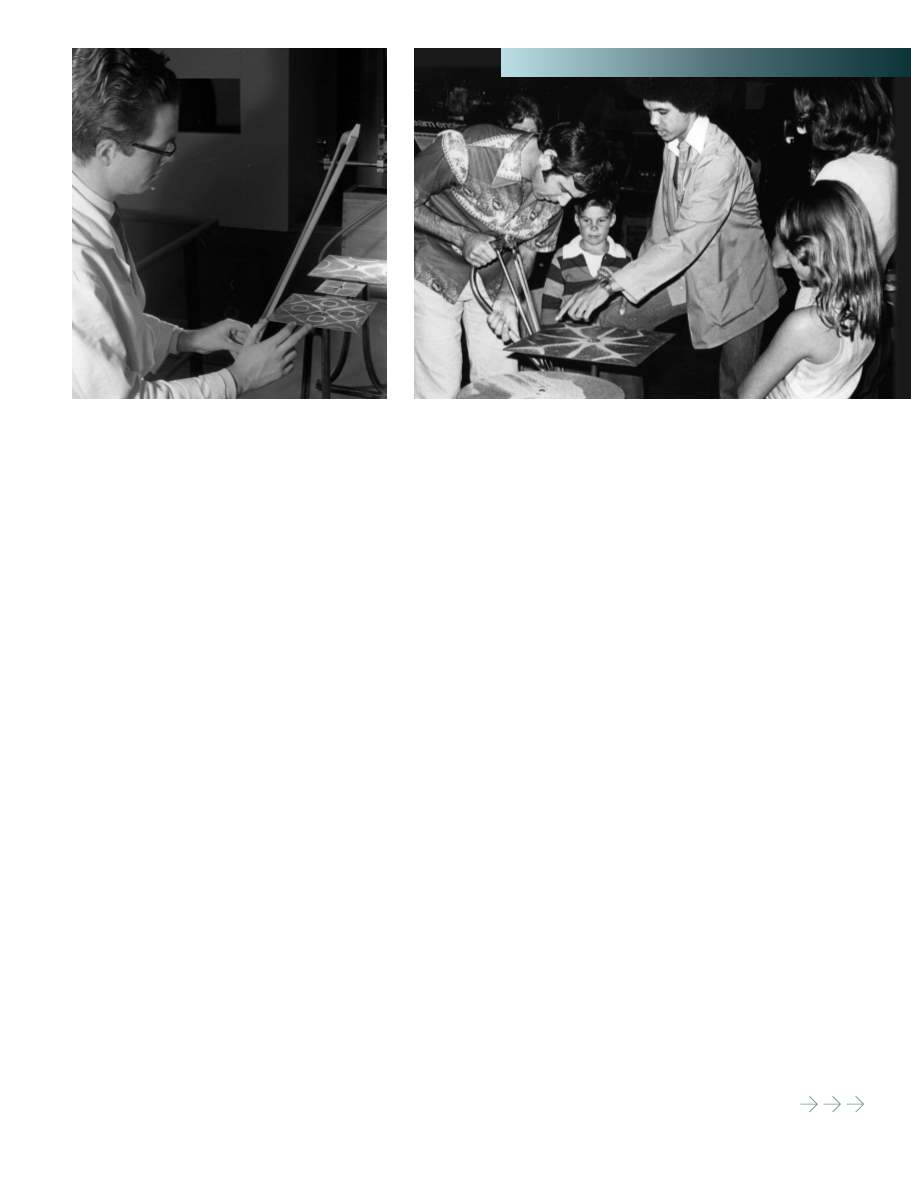
Figure 1.
expérience des figures de Chladni réalisée avec un archet de violon ou de violoncelle et une plaque métallique sur laquelle
est disposée une couche de sable, présentée dans la section de physique au Palais en mai 1967 (a) et à l’exploratorium en 1978 (b).
a) © g. ferron / universcience ; b) © exploratorium,
a)
b)
Point de vue
déCouVerTe N° 410 \ mai-JuiN 2017 \
25
artéfacts historiques, mais en leur propo-
sant à la place d’assister à des démons-
trations d’expériences réalisées par
des médiateurs et en leur fournissant
l’opportunité d’effectuer des expériences
autodirigées en accès libre sur des tables
équipées. En outre, il était possible
d’inviter les visiteurs à en apprendre
davantage sur le monde physique et le
processus scientifique à travers une
participation active à des expériences et
la manipulation d’instruments scienti-
fiques tels que des aimants, des lentilles
ou des pendules.
L’inspiration engendrée par le Palais de
la découverte a influencé de nombreux
musées de science au fil des années. En
1965, alors que le Palais était ouvert depuis
28 ans, le physicien Frank Oppenheimer
(1912-1985) le visita par curiosité pendant
qu’il était en Europe dans le cadre d’un
programme de recherche dont le thème
était l’histoire de la physique du XX
e
siècle.
Il a été captivé par les pratiques inno-
vantes du Palais, notamment l’exposition
d’équipement de laboratoire, les démons-
trations conduites par des étudiants à
l’université et l’accent mis sur les phéno-
mènes classiques.
LES SOURCES D’INSPIRATION
DE L’EXPLORATORIUM
Oppenheimer est revenu de sonprogramme
de recherche en Europe, après avoir visité
aussi le Deutsches Museum à Munich et le
Science Museum à Londres, avec la convic-
tion que lesmusées de science pourraient et
devraient jouer un plus grand rôle en tant
qu’institutions éducatives. Quatre ans après,
il a repensé et s’est approprié les idées du
Palais et celles d’autresmusées pour les inté-
grer à sonpropre « Exploratorium », ouvert à
San Francisco en 1969. Les nombreux points
communs entre le Palais de 1960 et l’Explo-
ratorium au début des années 1970 sont
frappants. En parcourant la publication de
l’université de Paris datant de 1968,
Le Palais
de la découverte
, il est aisé de trouver des
exemples d’expositions publiques du Palais
qui ont été traduites et reconstruites pour
devenir des expositions expérimentales
captivantes à l’Exploratorium pendant ses
premières années. Les expositions illustrées
évoquent des associations animées saisis-
santes pour qui connaît le Palais ou l’Explo-
ratorium : les mandalas formés par un son
bourdonnant et du sable s’agitant sur des
plaques vibrantes de Chladni (fig. 1) ; les